🔊 “Luc Delahaye” Le bruit du monde, au Jeu de Paume, du 10 octobre 2025 au 4 janvier 2026
“Luc Delahaye”
Le bruit du monde
au Jeu de Paume, Paris
du 10 octobre 2025 au 4 janvier 2026
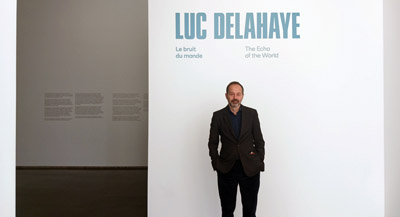
PODCAST – Entretien avec
Quentin Bajac,
directeur du Jeu de Paume et commissaire de l’exposition,
par Anne-Frédérique Fer, à Paris, 27 octobre 2025, durée 24’50,
© FranceFineArt.
Extrait du communiqué de presse :

Luc Delahaye, Un Feu, 2021. Tirage chromogène numérique. © Courtesy Luc Delahaye et Galerie Nathalie Obadia, Paris/Bruxelles.

Luc Delahaye, Ambush, 2006. Tirage chromogène numérique. © Courtesy Luc Delahaye et Galerie Nathalie Obadia, Paris/Bruxelles.

Luc Delahaye, Trading Floor, 2013. Tirage chromogène numérique. © Courtesy Luc Delahaye et Galerie Nathalie Obadia, Paris/Bruxelles.
Commissaire : Quentin Bajac, directeur du Jeu de Paume
Le Jeu de Paume consacre une grande exposition monographique à Luc Delahaye (né à Tours en 1962), couvrant sa production photographique entre 2001 et 2025. Cette période, déterminante dans son parcours, correspond à son retrait du photojournalisme et à son engagement dans le champ de l’art.
Grand photoreporter de guerre dans les années 1990 et ancien membre de l’agence Magnum, il fait partie d’une génération de photographes qui a retravaillé l’articulation entre pratiques documentaires et dimension artistique.
Depuis vingt-cinq ans, ses photographies, le plus souvent de grandes dimensions et en couleur, proposent une représentation des désordres du monde contemporain. De la guerre d’Irak à celle d’Ukraine, d’Haïti à la Libye, des conférences de l’OPEP à celles de la COP, Delahaye explore le bruit du monde et les lieux censés le réguler.
Parfois réalisées en une seule prise, parfois véritables compositions assemblées par ordinateur pendant des mois à partir de fragments d’images, les photographies de Luc Delahaye sont toujours une rencontre, qu’elle soit immédiate ou différée, avec un réel. Un réel qu’il s’agit d’énoncer, dans une forme de retrait documentaire, sans démonstration :
« Arriver par une forme d’absence, par une forme d’inconscience peut-être, à une unité avec le réel. Une unité silencieuse. La pratique de la photographie est une chose assez belle : elle permet cette réunification de soi avec le monde ».
L’exposition, la première à Paris depuis 2005, offre un regard rétrospectif sur vingt-cinq ans de création. Elle rassemble une quarantaine de grands formats, certains inédits et réalisés pour l’occasion, une vidéo autour du conflit syrien à laquelle Delahaye travaille depuis de longues années, ainsi qu’une grande installation dans un format nouveau pour l’artiste. Par ailleurs l’exposition sera
aussi l’occasion, au gré du parcours, de s’attarder sur le processus créatif, à travers sources visuelles et images rejetées.

Luc Delahaye, Taxi, 2016. Tirage chromogène numérique. © Courtesy Luc Delahaye et Galerie Nathalie Obadia, Paris/Bruxelles.

Luc Delahaye, Récolte, 2016. Tirage chromogène numérique. © Courtesy Luc Delahaye et Galerie Nathalie Obadia, Paris/Bruxelles.

Luc Delahaye, House to House, 2011. Tirage chromogène numérique. © Courtesy Luc Delahaye et Galerie Nathalie Obadia, Paris/Bruxelles.
#ExpoDelahaye
Dès la fin des années 1990, Luc Delahaye diversifie les modes de diffusion de ses images au-delà de la presse publiant notamment plusieurs livres d’auteur. Portraits/1, (1996) – suite de portraits de sans-abris réalisés dans des Photomaton –, Mémo (1997) – recueil de portraits de victimes de la guerre en Bosnie extraits des pages nécrologiques d’un journal de Sarajevo – ou L’Autre (1999) – série de portraits de voyageurs du métro pris à leur insu par le photographe sans visée à l’oeil – témoignent d’une volonté d’effacement de l’opérateur, de dépersonnalisation du regard. Ces stratégies d’évitement préfigurent une oeuvre qui, après 2001, poursuivra ce rapport singulier au réel.
Entre 2001 et 2005, Delahaye emploie un appareil panoramique, produisant des images de grandes dimensions et aux proportions allongées. Ce format permet un élargissement de la vision, une mise à distance du sujet et une lecture ouverte. L’opérateur semble absent ; le spectateur n’est jamais dans l’image, mais face à elle. Le panorama devient pour Delahaye un moyen de construire un espace d’observation dénué d’affect, propice à une vision élargie des situations humaines – qu’il s’agisse d’un camp de réfugiés, d’une réunion de l’ONU ou d’une cérémonie de funérailles au Rwanda.
À partir de 2005, la photographie panoramique cède la place à d’autres modalités : compositions numériques à partir de multiples prises, mises en scène. Delahaye cherche à capter la complexité d’une situation dans une seule image, tout en conservant une ambiguïté fondamentale, refusant toute interprétation univoque. Cette évolution s’accompagne d’un élargissement des formats, affirmant la présence de la figure humaine. Le détail devient essentiel : il ancre l’image dans le réel.
Avec le temps, Delahaye voyage moins, et moins longtemps ; l’ordinateur est son principal outil et sa pratique s’apparente davantage à celle d’une écriture. L’atelier, lieu de solitude et de composition, devient le laboratoire de développement d’une image essentiellement pensée. Le processus de transformation du réel se complexifie et s’allonge. Pourtant, le moment de la prise de vue demeure central, et les oeuvres sont toujours datées du jour de la capture initiale. Exemple révélateur de cette logique, Luc Delahaye date de 2012 l’œuvre Soldats de l’Armée syrienne, Alep, novembre 2012, une composition complexe réalisée en 2023 à partir de vues faites au cours du conflit syrien, et qui est montrée pour la première fois dans cette exposition. Cette fidélité à l’instant est révélatrice d’une tension entre travail de composition et présence au réel.
Les années 2010 attestent une ouverture du vocabulaire, qu’accompagne des expériences nouvelles : vidéo, retour au noir et blanc dans une esthétique impersonnelle, recherches pour dépasser l’image unique, par la séquence, la série ou le polyptyque. Le traitement de la figure humaine, lui aussi, évolue : les silhouettes deviennent des corps, à l’échelle du spectateur. Les individus représentés, souvent anonymes, acquièrent une valeur universelle. Delahaye dessine un peuple de douleurs : soldats, prisonniers, déplacés, enfants errants, personnes vulnérables, hommes et femmes absorbés dans leur tâche. L’image cherche moins à raconter qu’à donner une densité à ces présences silencieuses.
Ses travaux en Inde (2013), au Sénégal (2019-2020) et en Cisjordanie (2015-2017) constituent des ensembles clos, en marge de son oeuvre. Ils s’attachent à une forme de quotidienneté des faits et gestes, sous-tendue par des préoccupations spécifiques : la disparition programmée d’un village en Inde, le travail manuel et le sacré au Sénégal, la vie ordinaire et les formes de résistance en territoire occupé.
Aujourd’hui, Delahaye ne s’interdit aucune de ces pistes ou de ces méthodes – composition numérique, mise en scène, image instantanée –, même si la mise en scène et la composition demeurent primordiales pour élaborer des images affranchies à la fois de la subjectivité de l’auteur et de la contingence du réel. À travers le travail de Luc Delahaye, l’exposition du Jeu de Paume décrit un état du monde en ce premier quart du XXIe siècle. Un monde tourmenté et dominé par le tumulte. Un monde dans lequel les conflits et les guerres, ainsi que leurs échos – au sein des institutions et instances internationales, tiennent une place prépondérante.
Cette exposition sera accompagnée d’une publication de référence, sous la forme d’un catalogue raisonné reproduisant et inventoriant l’ensemble des 74 oeuvres créées par l’artiste au cours de ces vingt-cinq années.
Après le Jeu de Paume, l’exposition sera présentée à Photo Elysée à Lausanne du 6 mars au 31 mai 2026.






























